Si l’avis des
forces armées, leur point de vue, sur la découverte de l’univers
concentrationnaire se révèle des plus intéressants puisque étant l’un des
premiers avis extérieurs, on ne peut négliger les sentiments éprouvés par
les déportés eux-mêmes à cet instant qui allait énormément les marquer.
L’étonnement
est sans doute la plus forte émotion qu’ils ressentent dans les heures qui
suivent leur libération. Joseph Bialot, interné à Auschwitz, exprime cette
perte de repères par ces phrases : « une impression de mou. Et, chose
étonnante, l’effet soudain […] de ne plus avoir de boussole » ; « créer une
gigantesque industrie du meurtre implique certaines règles précises. Là,
elles ont disparu et la machine s’enraye ».

Des survivants à Dora

La pitié d'un soldat à Mauthausen
Pour les détenus hagards, demeurés dans les baraquements, abandonnés des SS, la première confrontation avec leurs libérateurs est source d’importants troubles.
Parfois ils
peuvent observer de la pitié sur le visage des soldats, non préparés à un
tel spectacle. A ce propos, Primo Lévi relate ses souvenirs en ces termes :
« Lorsqu’ils arrivèrent près des barbelés, ils s’arrêtèrent pour regarder,
en échangeant quelques mots brefs et timides, et en jetant des regards
lourds d’un étrange embarras sur les cadavres en désordre, les baraquements
disloqués et sur nous, rares survivants. » Ces « quatre messagers de paix »
« ne nous souriaient pas, à leur pitié semblait s’ajouter un sentiment
confus de gêne qui les oppressait […] ».
Mais l’émotion majeure qui ressort des témoignages reste la joie profonde ressentie par ces hommes à nouveau libres. Jean-Henry Tauzin raconte l’heure de sa libération à Dora : « Le 11 […], la journée se passe dans un calme qui nous effraie un peu […], nous attendons. Et tout à coup, vers 18 heures, se font entendre des bruits de moteur de motocyclettes. Nous regardons éperdus et le cœur battant […], c’est alors des hurlements de joie, des cris, des rires, des sanglots… Car nous avons reconnu des soldats américains. ».
De même,
Jean Dombras, alité car trop faible pour sortir de son baraquement, évoque
l’arrivée d’un soldat russe : « Tout de suite, un soldat saute, de lit en
lit, et vient me voir, c’est le premier sourire de sympathie que je viens de
voir depuis longtemps… ».
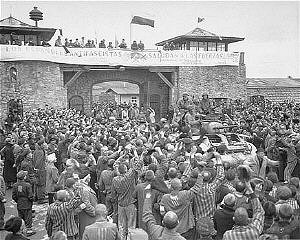
Acclamations des libérateurs à Mauthausen
Cependant, il
faut nuancer la nature des témoignages. Dans certains cas, les détenus, bien
que bienveillants à l’égard de leurs libérateurs, relativisent
l’enthousiasme général. Ainsi, Charles Palant, prisonnier à Buchenwald, note
un fait réel de la seconde guerre mondiale : « Nous étions, nous
constituions, un épisode de la guerre qu’ils [les Américains] étaient en
train de gagner. Ils ne sont pas venus pour libérer Buchenwald, ils sont
venus pour conquérir l’Allemagne ».

Simone Veil
De son côté
Simone Veil, rappelle que dans les jours qui suivirent la libération les morts
se comptaient encore par milliers : « Un grand nombre d’entre nous sont
mortes, après la libération du camp [Bergen-Belsen], du typhus, d’une
nourriture inadaptée ou de manque de soin. Je pense que beaucoup auraient pu
être sauvées, mais ce n’était pas une priorité. » « Nous avons eu le
sentiment que nos vies ne comptaient pas […] ». Par ces mots, elle évoque la
volonté première des Alliés : avancer le plus rapidement possible vers
Berlin.
Il faut
également noter que les forces armées ne libèrent pas seulement des camps,
mais ils tombent aussi sur des convois de déportés. Ceux-ci nous ont laissé
des témoignages de ces instants partagés entre le bonheur de la libération
et la peur de la répression des SS les surveillant encore. René Petitjean se
souvient : « Nous sommes harassés par la marche, mais il faut quand même
aller. Les SS, derrière notre colonne, nous poussent. Les Russes sont
derrière. Ils avancent vite, avec leurs convois motorisés ».
